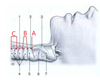UE 3.2 Flashcards
(324 cards)
Les complications de la transfusion :
Quel est la première cause de décès transfusionnel en France :
Œdème pulmonaire de surcharge
Les complications de la transfusion :
Avec quel produit les OAP par surcharge volémique sont les plus fréquent :
CGR (1 CGR augmente de 5 à 10% la masse sanguine)
Les complications de la transfusion :
Quels sont les facteurs favorisant l’apparitions d’un œdème pulmonaire de surcharge :
- Age > 70 ans
- Pédiatrie
- Antécédant cardiaque et/ou pulmonaire
Les complications de la transfusion :
Quels signes cliniques doivent faire évoquer l’OAP lors d’une transfusion, et quand peuvent-ils survenir :
Pouvant survenir jusqu’à 6 à 12 heure après la transfusion :
- Insuffisance respiratoire aigüe
- Polypnée, cyanose, toux
- Désaturation
- Crépitants bilatéraux
- HTA
Les complications de la transfusion :
Comment prévenir l’OAP lors d’une transfusion :
Adapter le débit de la transfusion aux capacités cardiovasculaires du patient
Les complications de la transfusion :
Quel est la conduite à tenir en cas d’OAP de surcharge :
- Arrêt de la transfusion
- Position ½ assise
- 02 nasal
- Diurétique et/ou dérivés nitrés selon PAS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Une intubation est difficile si elle nécessite plus de 2 laryngoscopies et/ ou la mise en œuvre d’une technique alternative après l’optimisation de la position de la tête, avec ou sans manipulation laryngée externe
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- En cas d’utilisation d’un mandrin comme aide à l’intubation, il est recommandé d’utiliser un mandrin long béquillé chez l’adulte et chez l’enfant (grade D)
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Il est possible d’utiliser un dispositif laryngé type fastrach chez l’enfant de moins de 30 kg
FAUX
CI du fastrach :
- OB < 20 mm
- Obstacle supra glottique
- Radiothérapie cervicale
- Enfant < 30 kg
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- En cas de cricothyroïdectomie, il est recommandé d’utiliser des dispositifs faisant appel à la technique de Seldinger
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Il n’y a pas de corrélation entre la classe de Mallampati et le Cormack
FAUX
Corrélation entre Mallampati 1 et Cormack 1 et Mallampati 4 et Cormack 4
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Il est recommandé d’envisager la pratique d’une laryngoscopie pour évaluer la difficulté réelle d’une ID
FAUX
Il n’est pas recommandé d’envisager la pratique d’une laryngoscopie pour évaluer la difficulté réelle d’une ID prévue sans avoir prévue une stratégie de prise en charge
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Le but du test de fuite est de limiter l’inhalation des sécrétions au-dessus du ballonnet
FAUX
Le but du test de fuite est de dépister l’œdème laryngé avant extubation
Le but de la toux passive est de limiter l’inhalation des sécrétions au-dessus du ballonnet
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Le but de la toux passive est de dépister l’œdème laryngé avant extubation
FAUX
Le but du test de fuite est de dépister l’œdème laryngé avant extubation
Le but de la toux passive est de limiter l’inhalation des sécrétions au-dessus du ballonnet
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- L’intubation difficile est la première cause de plainte liée à l’intubation
FAUX
La 1ère cause de plainte liée à l’IOT est le bris dentaire
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Il est recommandé d’utiliser qu’un seul produit en titration pour maintenir la VS lors d’une fibrointubation (ex : rémifentanil)
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Lors d’une fibrointubation, la ventilation spontanée est recommandée
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- Lors d’une intubation difficile, le maintien permanent de l’oxygénation est une priorité absolue
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais/Faux concernant l’intubation difficile :
- L’intubation difficile est la 2ème cause de mortalité et de morbidité en anesthésie
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais / Faux concernant la sédation pour une fibrointubation pour intubation difficile prévue :
- Les concentration cibles initiales recommandées sont 7 µg/ml pour le propofol et 7 à 8 ng/ml pour le rémifentanil
FAUX
L’intubation difficile :
Vrais / Faux concernant la sédation pour une fibrointubation pour intubation difficile prévue :
- Le propofol est l’hypnotique le plus adapté
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais / Faux concernant la sédation pour une fibrointubation pour intubation difficile prévue :
- Le rémifentanil semble être le morphinique de choix
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais / Faux concernant la sédation pour une fibrointubation pour intubation difficile prévue :
- L’AIVOC est particulièrement adapté à cette situation
VRAIS
L’intubation difficile :
Vrais / Faux concernant la sédation pour une fibrointubation pour intubation difficile prévue :
- L’administration conjointe de rémifentanil et propofol est déconseillée en raison d’un risque majoré d’apnée
VRAIS