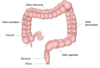Investigation : Gazométrie/Ponction pleurale/Rx abdo/Rx pulmonaire Flashcards
(109 cards)
Le gaz artériel se fait où? (2)
- est habituellement fait au niveau de l’artère radiale
- ou sinon de l’artère fémorale au niveau du pli de l’aine.
Le gaz capillaire se fait où? (3)
- peut être fait au niveau de différents endroits.
- Chez les nouveau-nés il est habituellement fait au niveau du talon.
- Dès l’âge de un an et jusqu’à l’âge adulte, il peut être fait au bout du doigt.
C’est quoi la différence entre les résultats du gaz artériel et capillaire? (2)
- vient du fait que la différence de la pression partielle d’oxygène (pO2) est plus grande dans le sang capillaire que dans le sang artériel.
- En effet, par rapport à la pO2 du sang artériel, la pO2 du sang capillaire est plus basse d’environ 20 mm Hg à 30 mm Hg.
La gazométrie sanguine est comment chez des patients dont l’état hémodynamique est significativement instable? (2)
- Chez des patients dont l’état hémodynamique est significativement instable, le degré d’extraction de l’oxygène et le métabolisme cellulaire sont altérés.
- Il n’y a donc plus de corrélation entre les valeurs de pH, de pCO2 et de bicarbonates et l’écart est plus grand entre les valeurs du sang artériel et du sang capillaire/veineux.
Nommez les avantages : Gazométrie artérielle (2)
- Méthode de référence
- À préconiser si hémodynamie instable (PaO2 plus précise)
Nommez les avantages : Gazométrie capillaire (4)
- Utile chez les enfants
- À préconiser si hémodynamie stable
- Peu douloureux, simple, non invasif
- Peut être fait par infirmière
Nommez les désavantages : Gazométrie artérielle (4)
- Invasif
- Plus difficile d’accès
- Complications : thrombose, hématome, dissection artérielle, douleur, risque de piqure accidentelle
- Doit être fait par un médecin
Nommez les désavantages : Gazométrie capillaire (2)
- Plusieurs facteurs d’influence
- PaO2 moins précise
Nommez les facteurs d’influence : Gazométrie capillaire (4)
- application ou non de chaleur avant échantillonnage,
- présence de bulles d’air,
- temps d’entreposage,
- exposition à l’air libre
Une gazométrie est pertinente dans quels contextes cliniques? (4)
- Suspicion d’intoxication
- Baisse de l’état de conscience
- Hémodynamie instable
- Troubles respiratoires (hypo ou hyperventilation)
Nommez : Étapes pour interpréter les résultats de la gazométrie sanguine
- Évaluer le pH : acidémie ou alcalémie ?
- Analyser les valeurs de PaCO2 et de HCO3- : trouble respiratoire ou métabolique ?
- Calculer les compensations : trouble simple ou mixte (ex. : PaCO2 et HCO3- vont dans des directions opposées) ?
- Calculer les « trous » : trou anionique sanguin, trou anionique urinaire et trou osmolaire
Si >50 000 polynucléaires/mm3 dans liquide pleural, pensez à quoi? (1)
empyème
Si > 10 000 polynucléaires/mm3 dans liquide pleural, pensez à quoi? (1)
processus aigu
Si il y a un prédominance lymphocytaire (70 % à totales) dans liquide pleural, pensez à quoi? (2)
- pleurésie tuberculeuse
- néoplasie maligne
Si Éosinophiles > 10 % cellules totales dans liquide pleural, pensez à quoi? (2)
- pathologie bénigne associée à la présence de sang ou d’air (pneumothorax- hémothorax – épanchement bénin associé à l’amiante, médication);
- rarement un cancer.
Si Globules rouges > 100 000/mm3 dans liquide pleural, pensez à quoi? (2)
- traumatisme;
- néoplasie
Si ph < 7.3 dans liquide pleural, pensez à quoi? (4)
- infection du liquide pleural;
- pleurésie tuberculeuse;
- pleurésie rhumatoïde;
- cancer.
Si glucose < 3,3 mmol/litre dans liquide pleural, vous pensez à quoi? (4)
- pleurésie rhumatoïde;
- épanchement parapneumonique ou empyème;
- néoplasie;
- pleurésie tuberculeuse.
Si amylase pleurale > limite supérieure de la valeur sérique normale, pensez à quoi? (2)
- pancréatite aigue;
- rupture œsophagienne.
Comment différencier un épanchement pleural de type transsudat versus exsudat ? (1)
avec le résultat d’une ponction pleurale (critères de Light).
Nommez les critères de Light
Si un des trois critères est présent, il s’agit d’un exsudat

Un transsudat résulte de quoi?
secondaire à un déséquilibre entre la pression oncotique et hydrostatique (IC est une cause fréquente)
L’exsudat résulte de quoi? (1)
résulte d’une inflammation pulmonaire ou pleurale amenant une fuite protéique
Identifier les structures anatomiques visibles sur la radiographie abdominale (10)
- Bulle d’air gastrique
- Foie
- Rate
- Reins
- Vessie
- Muscle psoas
- Intestin grêle et colon
- Côtes inférieures
- Colonne et sacrum
- Bassin et hanche